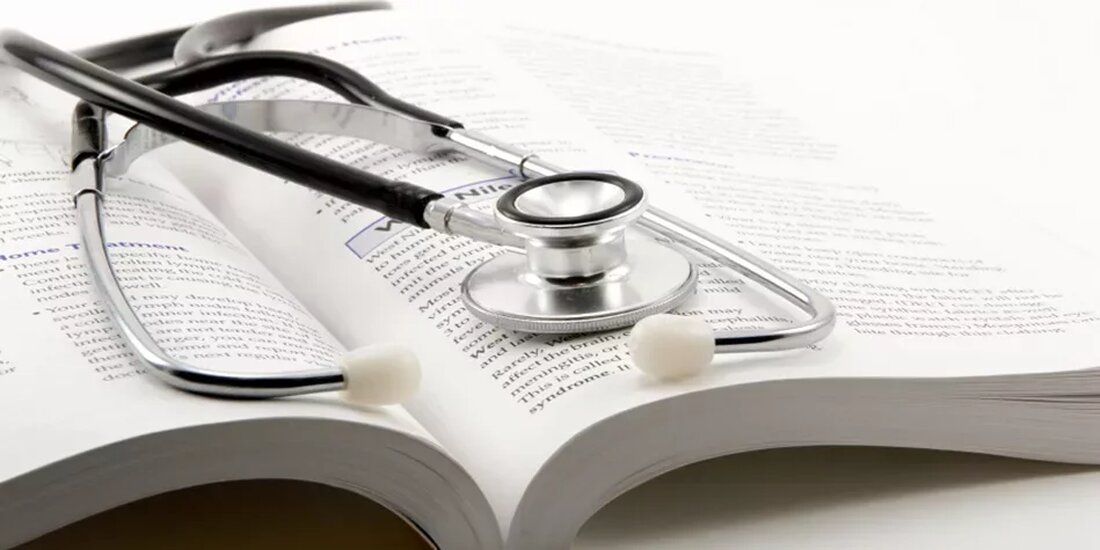Relation
Yeager, R., Riggs, D., DeJarnett, N. et coll. Association entre verdure résidentielle et risque de maladies cardiovasculaires.J-Am Heart Assoc. 2018;7(e009117).
Objectif de l'étude
Évaluation des effets des espaces verts résidentiels sur les marqueurs des maladies cardiovasculaires (MCV)
Conception et participants
Il s'agissait d'une étude transversale portant sur 408 participants (48 % de femmes, âge moyen 51,4 ± 10,8 ans) qui étaient des patients de la clinique cardiovasculaire ambulatoire de l'Université de Louisville entre 2009 et 2014. Tous les participants ont été recrutés sur la base de facteurs de risque cardiovasculaire légers à modérés (par exemple, IMC moyen 32,9, pression artérielle moyenne 131/80) et/ou antécédents d'événements cardiaques antérieurs.
Paramètres cibles
Les adresses personnelles des participants ont été cartographiées à l'aide d'un logiciel de système d'information géographique (SIG) et corrélées spatialement avec les données satellitaires actuelles de l'indice de végétation par différence normalisée (NDVI) afin d'évaluer la quantité relative d'espaces verts environnants dans des cercles de 250 m et 1 km de rayon en utilisant une méthode standardisée de -0,1 (complètement urbain/pas de végétation) à 0,9 (forêts denses).
Des données sur les biomarqueurs urinaires et sanguins ont été collectées auprès de chaque participant pour évaluer le risque, les dommages et/ou la réparation cardiovasculaires actuels, comme suit :
- Kardiovaskuläres Risiko: Adrenalin-, Noradrenalin-, Dopamin-, Serotonin-, Normetanephrin-, 3-Methoxytyramin-, Metanephrin-, 5-Hydroxyindol-3-Essigsäure-, Homovanillinsäure- und Vanillylmandelsäurekonzentrationen im Urin, alles Marker der sympathischen neuroendokrinen Aktivierung, von denen bekannt ist, dass sie zu kardiovaskulären Erkrankungen beitragen.
- Herz-Kreislauf-Schäden: F2-Isoprostan im Urin, ein Marker für oxidativen Stress.
- Herz-Kreislauf-Reparatur: Untertypen 1-15 der Serum zirkulierenden angiogenen Zellen (CAC), die das erneute Wachstum der Gefäße nach einer Schädigung widerspiegeln.
Tous les échantillons ont été collectés entre 13h00 et 16h00. pour minimiser les fluctuations circadiennes. Les échantillons d'urine ont été standardisés pour les niveaux de créatinine.
Les biomarqueurs des patients et les données NDVI ont été analysées à l'aide d'un logiciel de corrélation spatiale SIG. Tous les résultats ont été ajustés en fonction de multiples facteurs démographiques, cliniques, résidentiels et environnementaux, notamment l'âge, le sexe, l'origine ethnique, le statut tabagique, l'IMC, l'utilisation de statines, le revenu médian des ménages, l'indice de défavorisation de la zone, la densité des routes à moins de 50 m de la résidence et la concentration de PM2,5 (particules fines d'un diamètre <2,5 micromètres) pollution de l'air à l'extérieur de la maison à toutes fins statistiques.
Informations clés
Après ajustement pour tous les facteurs mesurés énumérés ci-dessus, les données montrent une association inverse significative entre les espaces verts résidentiels et toutes les catégories de biomarqueurs, notamment les suivantes :
- Abnahme der Epinephrinkonzentration im Urin mit zunehmender Wohnbegrünung (−6,9 % pro Δ 0,1 NDVI; 95 % KI: −11,5 % bis −2,0 %, P=0,006) innerhalb von 250 m, mit statistischer Signifikanz bei 1 km.
- Abnahme der F2-Isoprostan-Konzentration im Urin mit zunehmender Wohnbegrünung (−9,0 % pro Δ 0,1 NDVI; 95 % KI: −15,1 % bis −2,5 %, P=0,007) bei 250 m, mit statistischer Signifikanz bei 1 km.
- Abnahme relevanter CAC-Konzentrationen im Serum mit zunehmender Wohngrünfläche innerhalb von 250 m (Effektstärken zwischen –8,0 % und –15,6 %) und 1 km (Effektstärken zwischen –6,9 % und –10,1 %).
Les données ont montré des associations encore plus prononcées pour certains groupes, notamment les femmes, les participants qui ne prenaient pas de bêtabloquants et les participants sans antécédents d'infarctus du myocarde.
Implications sur la pratique
Cette étude est publiée dansJournal de l'American Heart Associationet démontre l’intérêt croissant du système médical conventionnel aux États-Unis pour les questions de nature et de santé. Des disciplines telles que l’urbanisme, la santé publique et les parcs et loisirs étudient depuis de nombreuses années les effets bénéfiques des espaces verts. C'est agréable de voir davantage de revues médicales s'intéresser à ce sujet.
Les résultats de la présente étude, actuellement en cours d’examen, ne devraient pas surprendre. Des études empiriques ont rapporté les effets positifs de l’exposition aux espaces verts depuis de nombreuses décennies.1L'une des premières de ces études, publiée dansLa lancetteil y a plus de dix ans, a montré une réduction significative de la mortalité cardiovasculaire chez les personnes vivant dans des zones entourées de grands espaces verts, en utilisant l'ensemble des données du British National Health Service portant sur 41 millions de personnes.2D'autres études ont montré des associations similaires entre les espaces verts et les maladies coronariennes et les accidents vasculaires cérébraux.3.4
Comme le suggèrent les biomarqueurs utilisés dans cette étude, le principal mécanisme d’action proposé est la modulation de la réponse psychophysiologique au stress, avec pour conséquence des effets sur la santé physique et mentale. Ceci est parfois appelé « charge allostatique ».5.6De nombreuses recherches récentes ont démontré la relation entre les facteurs environnementaux du quartier et l'augmentation de la charge allostatique.7.8et des décennies de recherche ont exploré l'effetaiguExposition aux espaces verts sur les biomarqueurs du stress.9Cette étude actuelle est l'une des premières à utiliser des biomarqueurs neuroendocriniens et de réparation vasculaire dans une étude sur les espaces verts résidentiels, élargissant ainsi les preuves d'un mécanisme d'action des résultats épidémiologiques cardiovasculaires mentionnés ci-dessus basé sur la réduction du stress psychophysiologique et de la charge allostatique.
restrictions
En tant qu'étude transversale, les données présentées ici ne peuvent montrer que des associations entre les espaces verts résidentiels et les biomarqueurs de maladies cardiovasculaires. Il ne peut pas établir de causalité et, comme il n’a pas été demandé aux participants combien de temps ils passaient là où ils vivaient, il se peut qu’il ne reflète pas avec précision la manière dont la durée d’exposition aux espaces verts influence les résultats de ces biomarqueurs.
Il est plus intéressant de savoir pourquoi l'épinéphrine est le seul biomarqueur neuroendocrinien urinaire (sur les 10 testés) qui a montré une association. Si les espaces verts résidentiels ont un impact sur le fonctionnement psychophysiologique, comme l’ont rapporté d’autres études, pourquoi ces autres biomarqueurs ne reflètent-ils pas ces changements ? Il se peut que les fluctuations de ces marqueurs soient trop transitoires pour mesurer les effets de base des expositions chroniques à domicile, auquel cas d'autres marqueurs tels que le cortisol pourraient être plus appropriés. D'autres études ont examiné cette approche avec des résultats positifs.10
Cette étude est publiée dansJournal de l'American Heart Associationet démontre l’intérêt croissant du système médical conventionnel aux États-Unis pour les questions de nature et de santé.
En outre, il est intéressant de noter qu’une étude mesurant le risque cardiovasculaire n’a pas utilisé de biomarqueurs cardiovasculaires plus conventionnels tels que la protéine C-réactive de haute sensibilité (hs-CRP) ou le fibrinogène, alors que ces marqueurs sont connus pour répondre au stress psychophysiologique. Tous les biomarqueurs de risque de cette étude ont été collectés via un échantillon d'urine, mais du sang a été collecté auprès de chaque participant pour évaluer la capacité de réparation vasculaire via le comptage CAC, permettant la collecte de hs-CRP ou de fibrinogène. Il se peut que ces derniers marqueurs reflètent une activité immunologique inflammatoire plutôt qu'un stress neuroendocrinien. Quoi qu’il en soit, les études futures pourraient souhaiter élargir leur collection de différents biomarqueurs pour permettre une enquête plus robuste sur les mécanismes potentiels.
Conclusions
Les maladies cardiovasculaires restent une cause majeure de morbidité et de mortalité. Il existe des preuves que des facteurs environnementaux tels que la proximité et l’exposition à des espaces verts récréatifs influencent les mécanismes de stimulation, d’oxydation et de réparation qui ont un impact sur la santé cardiovasculaire. Il peut être bénéfique sur les plans clinique et économique de soutenir l’entretien et l’accès à ces espaces verts dans le cadre d’une approche préventive holistique visant à réduire le fardeau de la maladie.

 Suche
Suche
 Mein Konto
Mein Konto