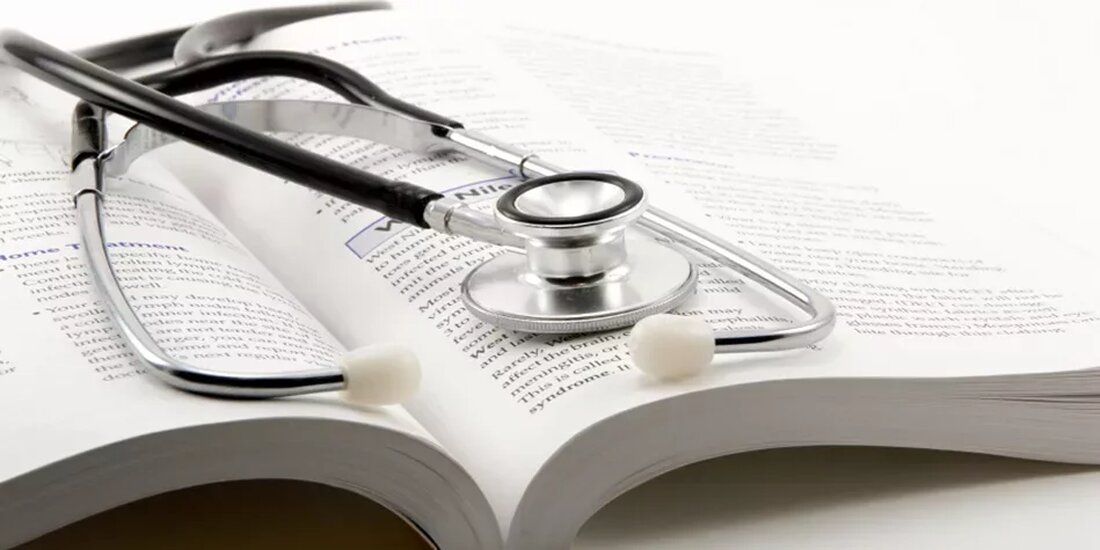Relation
Miller MR, Raftis JB, Langrish JP et al. Les nanoparticules inhalées s'accumulent sur les sites de maladies vasculaires.ACS Nano. 2017;11(5):4542-4552.
Objectif
Déterminer si les nanoparticules inhalées provoquent directement des maladies cardiovasculaires (MCV) en se déplaçant dans les poumons ou si elles déclenchent simplement des réponses inflammatoires systémiques.
Brouillon
Cet article rapporte les résultats d'une série d'études cliniques et animales, chacune conçue pour répondre à une question spécifique sur la manière dont les nanoparticules contribuent aux maladies cardiovasculaires. Dans chaque étude, les participants ont été exposés à des nanoparticules d’or soit par inhalation (humains), soit par instillation directe par la trachée (souris), suivie d’échantillons de sang, d’urine ou de tissus.
Participant
Les première (N = 14 hommes) et deuxième (N = 19) études impliquaient des volontaires humains en bonne santé ; Les participants à la troisième étude humaine étaient des patients ayant récemment subi un accident cardiovasculaire et devant subir une endartériectomie carotidienne (N = 12). La première expérience sur des rongeurs incluait des souris normales ; la seconde impliquait des souris knock-out pour l'apolipoprotéine E (ApoE-/-) qui ont été nourries avec un régime riche en graisses pour accélérer le développement de lésions athéroscléreuses.
Interventions
Dans toutes les expériences, les participants ont été exposés à des nanoparticules d’or, mais la taille des particules et la durée de l’exposition variaient. Les participants au premier essai humain ont été exposés à une moyenne de particules de 3,8 nm pendant 2 heures ; Dans la deuxième étude humaine, 10 personnes ont été exposées à de petites particules (~ 4 nm) et 9 à de grosses particules (34 nm). Lors de la première expérience animale, des souris ont été exposées à différentes tailles allant de 2 à 200 nm ; Dans la deuxième expérience animale, des souris ont été exposées à des particules de 5 nm pendant 5 semaines. Dans la troisième étude humaine, 3 des 12 patients ont été exposés à des nanoparticules d'or inhalées (5 nm) pendant 4 heures avant l'intervention chirurgicale.
Les connaissances issues de cette étude peuvent nous aider à éviter une augmentation de la morbidité en encourageant la mise en œuvre de pratiques de fabrication et de manipulation sûres pour réduire les expositions accidentelles.
Les nanoparticules d'or ont été utilisées car elles sont de taille similaire aux nanoparticules dérivées de la combustion mais ont une faible activité biologique ; ils sont également plus faciles à mesurer. Étant donné que les niveaux d’or endogènes dans le sang sont faibles, les enquêteurs pourraient supposer que tout matériau détecté a été obtenu expérimentalement.
Paramètres cibles
Concentrations de nanoparticules d'or dans le sang, l'urine et le tissu de la plaque carotidienne (expérience animale 2 et expérience humaine 3). Les teneurs en or ont été déterminées par spectroscopie de masse à plasma inductif à haute résolution (HR-ICPMS) et par microscopie Raman.
Résultats
De l'or a été détecté dans le sang de volontaires sains exposés à des nanoparticules inhalées dans les 15 minutes et était toujours présent 3 mois après l'exposition. Les concentrations étaient significativement plus élevées après l'inhalation de particules plus petites (4 à 5 nm) par rapport aux particules plus grosses (30+ nm). Chez la souris, l’accumulation était significativement plus importante dans les particules plus petites (<10 nm) que dans la gamme plus grande (10 à 200 nm).
Dans les études sur l’homme et l’animal, les nanoparticules d’or se sont accumulées préférentiellement dans les zones de plus grande inflammation, en particulier dans les lésions vasculaires. Les auteurs concluent que les nanoparticules d’or inhalées pénètrent rapidement dans la circulation systémique et s’accumulent aux sites d’inflammation vasculaire. Cela fournit un mécanisme direct expliquant l’association entre les nanoparticules environnementales et les maladies cardiovasculaires.
Implications cliniques
Ces dernières années, diverses études ont rapporté des associations significatives entre l’exposition par inhalation aux nanoparticules provenant des gaz d’échappement des véhicules et le risque de morbidité et de mortalité. Nous avons maintenant une explication décente du pourquoi et du comment cela se produit. En outre, la croissance rapide de la production et de l’utilisation de nanomatériaux pourrait potentiellement accroître considérablement l’exposition humaine. Les connaissances issues de cette étude peuvent nous aider à éviter une augmentation de la morbidité en encourageant la mise en œuvre de pratiques de fabrication et de manipulation sûres pour réduire les expositions accidentelles. À ce jour, notre compréhension d’un mécanisme d’action qui expliquerait l’association avec les maladies cardiovasculaires est rudimentaire. Cet article fait progresser notre compréhension et incite certainement à la prudence.
Les auteurs ont montré que les nanoparticules inhalées passent des poumons dans la circulation chez l'homme et que les particules s'accumulent au niveau des sites d'inflammation vasculaire. La translocation des particules semble dépendre de la taille, avec une plus grande translocation et une accumulation de nanoparticules plus petites.
Des recherches antérieures montrent qu'une exposition aiguë aux gaz d'échappement diesel provoque un dysfonctionnement vasculaire, une thrombose et une ischémie myocardique chez les individus en bonne santé et chez les patients atteints de maladie coronarienne.1L'exposition chronique à la pollution atmosphérique particulaire est associée au développement et à la progression de l'athérosclérose chez les animaux et les humains.2
Mais on ne savait pas comment cela se produisait. On sait que les particules inhalées se logent profondément dans les poumons et déclenchent un stress oxydatif et une inflammation.3Une théorie est que les médiateurs inflammatoires déclenchés par ces particules pénètrent dans la circulation générale et influencent le risque de maladie. D’autres pensent que les nanoparticules elles-mêmes pénètrent dans l’épithélium alvéolaire et entrent dans la circulation, contribuant ainsi directement à la maladie.4Cet article suggère fortement que ce dernier mécanisme est plus probable. Ce n'est probablement pas un choix si facile. Au final, on comprendra probablement que les nanoparticules déclenchent une inflammation des tissus, ce qui augmente la translocation des particules.5
Bien que les résultats de la présente étude fournissent une explication convaincante de la manière dont le risque de maladies cardiovasculaires peut être lié à l'exposition aux nanoparticules dans l'environnement, ils ne suggèrent qu'une explication possible des résultats rapportés par Bakian et al Seestadt,6ou les résultats d'une étude observationnelle de Power et al., qui ont établi un lien entre la pollution de l'air et l'anxiété.7Ces 2 publications suggèrent que les nanoparticules non seulement pénètrent dans la circulation générale, mais traversent également la barrière hémato-encéphalique et déclenchent également des maladies mentales.
Cette étude ne prouve pas de relation causale. Les données montrent uniquement que les nanoparticules s’accumulent sur les sites de maladies vasculaires ; ils ne prouvent pas que les nanoparticules provoquent ou aggravent les maladies cardiovasculaires.
Les résultats de cet article et d'études similaires devraient inquiéter nos patients souffrant ou à risque de maladie cardiovasculaire. Limiter l’exposition aux sources évidentes de nanoparticules inhalées, en particulier les gaz d’échappement des moteurs diesel, peut contribuer à limiter la progression de la maladie. Toutefois, des sources d’exposition moins évidentes aux nanoparticules présentent également des risques. Le nombre de nanoparticules dans notre environnement quotidien ne cesse d’augmenter. Par exemple, rares sont ceux qui reconnaîtraient les encres de toner utilisées dans l'impression à domicile et au bureau comme un risque de maladies cardiovasculaires, mais elles libèrent des nanomatériaux (utilisés pour améliorer les performances du toner) et ont été associées à des problèmes respiratoires.8Les colorants alimentaires contiennent également des nanoparticules de dioxyde de titane, qui peuvent pénétrer dans l’organisme et provoquer un stress oxydatif.9
Cet article élargit notre compréhension des problèmes causés par le diesel et d’autres sous-produits de la combustion de combustibles fossiles. La taille et le nombre de particules dans l’air pourraient en fin de compte avoir plus d’importance que la masse absolue, car les particules plus petites peuvent constituer une menace plus grande. Cet article nous alerte également sur le danger potentiel posé par diverses nanosubstances considérées comme inoffensives, non pas en raison de leurs composants chimiques, mais en raison de leur taille et de leur capacité à se déplacer puis à s'accumuler sur les sites d'inflammation.

 Suche
Suche
 Mein Konto
Mein Konto