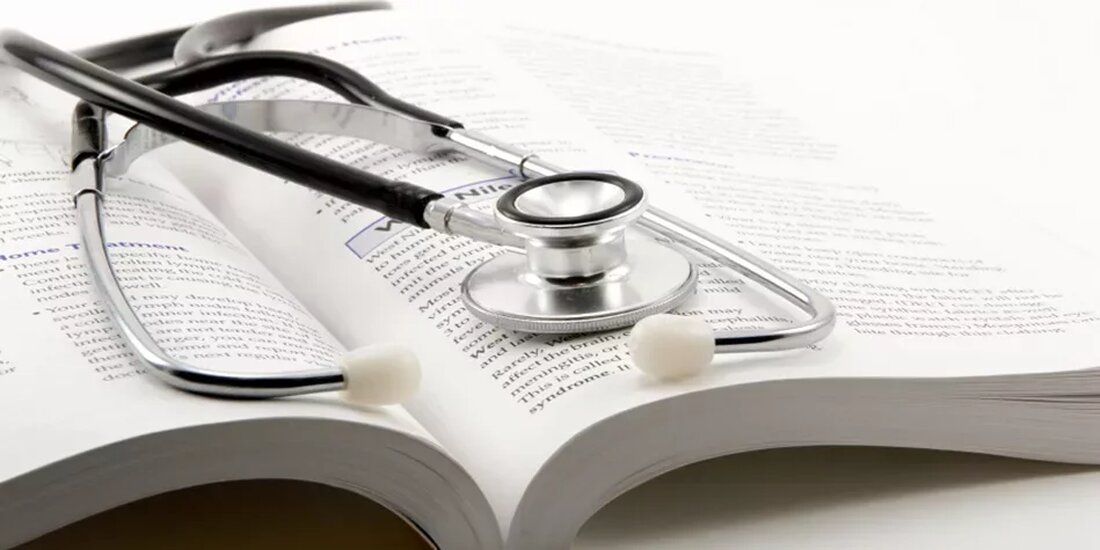Tian T, Shao J, Shen Z et al. Association entre la vitamine C sérique et les décès toutes causes confondues et par cause : données de l'Enquête nationale sur la santé et la nutrition (NHANES 2003-2006).Nutrition. 2022;101:111696.
Objectif de l'étude
Examiner l'association non linéaire entre la vitamine C sérique et la mortalité toutes causes confondues ou spécifiques à une cause.
Clé à emporter
La vitamine C n’est peut-être pas aussi inoffensive qu’on le croit généralement.
conception
Étude observationnelle de l'Enquête nationale sur la santé et la nutrition (NHANES 2003–2006)
Participant
Dans cette étude, les chercheurs ont analysé les données des participants à NHANES 2003-2006, en particulier les deux cycles NHANES (2003-2004 et 2005-2006) au cours desquels les concentrations sériques de vitamine C ont été testées.
Sur les 20 470 participants initiaux, environ la moitié ont été exclus, principalement en raison de données manquantes sur la vitamine C. Au final, 9 902 participants ont été inclus dans l’analyse.
L'âge moyen des personnes incluses dans l'analyse était de 45,6 ans ; 51,6% étaient des femmes. La race/origine ethnique auto-identifiée était la suivante : 72 % de blancs non hispaniques, 11,2 % de noirs, 8 % d'Américains d'origine mexicaine, 3,5 % d'autres hispaniques et 5,3 % d'autres races.
Interventions
Le taux sérique de vitamine C (mg/dL) était la principale variable d’exposition d’intérêt.
Les chercheurs l’ont découvert en utilisant la chromatographie liquide isocratique à haute performance dans divers laboratoires.
Paramètres de l'étude évalués
Les variables de résultat comprenaient les décès toutes causes confondues et les décès par cause spécifique. Les chercheurs ont obtenu ces données en faisant correspondre les données du NHANES avec les enregistrements du National Death Index (NDI).
Résultat principal
Cette étude visait à examiner la possibilité que la réponse à la dose de vitamine C ne soit pas linéaire (c'est-à-dire que des doses plus élevées pourraient ne pas avoir les mêmes avantages que de faibles doses).
Principales conclusions
Au cours d'un suivi médian de 10,6 ans, 1 558 décès toutes causes confondues ont été enregistrés, dont 320 par cancer, 374 par maladie cardiovasculaire (MCV) et 120 par maladie respiratoire.
Il y avait une association significativement plus élevée entre la mortalité toutes causes confondues et la mortalité associée aux maladies cardiovasculaires pour les personnes appartenant aux quintiles inférieur et supérieur de vitamine C circulante (courbe de relation en forme de U).
Les auteurs ont conclu : « Il est intéressant de noter que les taux sériques de vitamine C inférieurs au seuil (1,06 mg/dL) étaient associés négativement à la mortalité toutes causes confondues (risque relatif (HR) entièrement ajusté ; intervalle de confiance (IC) à 95 % 0,590). 86) et aux maladies cardiovasculaires (HR entièrement ajusté : 0,70 ; IC à 95 % : 0,471,03). Les taux de vitamine C supérieurs au seuil (1,06 mg/dL) étaient positifs, toutes causes confondues (HR entièrement ajusté, 1,33 ; IC à 95 %, 1 151,54) et les maladies cardiovasculaires (HR entièrement ajustés, 1,60, 95) associées à un % IC, 1 232,10).
Bien que l’association entre la vitamine C, le cancer et les maladies respiratoires n’ait pas atteint une signification statistique, des tendances claires ont été observées dans les données indiquant une éventuelle association positive pour ces maladies également.
transparence
Source de financement divulguée et aucun problème de transparence soulevé.
Implications et limites pour la pratique
Si les résultats de cette étude de Tian et al. Si les résultats rapportés sont valides, nous devrions remettre en question nos hypothèses de longue date concernant la sécurité des vitamines hydrosolubles. Avant d’examiner les implications de ces données, considérons d’abord les arguments en faveur de la validité de ces résultats.
Ces résultats sont basés sur des données épidémiologiques plutôt que sur des essais cliniques randomisés, et on a aujourd'hui tendance à s'appuyer davantage sur les données d'études aveugles que sur les données épidémiologiques. Néanmoins, NHANES reste l'une des cohortes les plus fiables en matière de collecte de données et a permis aux auteurs de l'article d'ignorer de nombreux facteurs de confusion possibles.
En comparant les caractéristiques des participants à l’étude en fonction des concentrations de vitamine C, les participants classés dans le quintile 5 (ceux ayant les niveaux de vitamine C les plus élevés) étaient plus susceptibles d’être blancs, plus instruits, plus actifs physiquement, plus riches et de consommer plus de fruits et légumes que ceux ayant des niveaux de vitamine C plus faibles. Ils étaient également moins susceptibles de fumer, de souffrir de diabète ou d’être en surpoids (indice de masse corporelle (IMC) moyen le plus bas de tous les quintiles). Ceux du quintile 5 présentaient également les niveaux moyens d’homocystéine et de protéine C-réactive (CRP) les plus bas de tous les participants. Sur la base de ces caractéristiques, on peut prédire que ces personnes auraient le risque de décès le plus faible au cours de la période d'étude, mais qu'elles présentaient plutôt un risque de décès 77 % plus élevé que celles du quintile 3, dont les niveaux de vitamine C étaient égaux ou proches de la médiane des participants à l'étude.
Ces dernières années, il est devenu courant dans les publications scientifiques de décrire les réponses à la dose hormétique en forme de U ou de J, le terme hormèse étant complètement éliminé de la discussion.
Deuxièmement, bien que cette association entre des niveaux élevés de vitamine C et des taux de mortalité ou de morbidité semble inattendue, ce n’est pas la première fois qu’un tel schéma de risque non linéaire est signalé. Les auteurs notent que cette étude a été spécifiquement conçue pour étudier ce phénomène, comme indiqué dans des recherches antérieures.
En 2016, Cadeau et al. sur l'apport en vitamine C et le risque de cancer du sein. Ils ont comparé l’apport en vitamine C dans 2 482 cas de cancer du sein invasif survenus chez 57 403 femmes ménopausées dans une cohorte prospective de 581 085 années-personnes. Ils ont utilisé des questionnaires sur la fréquence des aliments pour estimer l'apport en vitamine C et ont rapporté que, même si la prise de suppléments de vitamine C n'était pas associée au risque de cancer du sein dans tous les quintiles, "l'utilisation de suppléments de vitamine C était associée à un risque accru de cancer du sein postménopausique".chez les femmes ayant un apport alimentaire élevé en vitamine C. «Nos données suggèrent une possible association en forme de U ou de J entre l'apport total en vitamine C et le risque de cancer du sein postménopausique, qui nécessite des recherches plus approfondies» (c'est nous qui soulignons).1
En 2018, une vaste revue et méta-analyse de Jayedi et al., qui ont examiné « les antioxydants alimentaires, les concentrations d'antioxydants en circulation, la capacité antioxydante totale et le risque de mortalité toutes causes confondues », ont rapporté que même si la plupart des antioxydants étaient associés à un risque de décès plus faible, leurs données composites décrivaient une association en forme de U entre la vitamine C et la mortalité.2
Toutes les études ne retrouvent pas ce type de courbe. La publication de Wang et al. en 2018, une vaste cohorte chinoise a révélé que des taux plasmatiques plus élevés de vitamine C étaient associés à un risque plus faible de maladie cardiaque et de cancer chez des sujets âgés sélectionnés au hasard ; Cette association suivait une association plus simple et linéaire.3
Ces rapports précédents ont conduit à cette étude actuelle, qui visait à déterminer si des niveaux progressivement plus élevés de vitamine C pouvaient influencer le risque. Des études antérieures se sont concentrées sur la comparaison de concentrations inadéquates et suffisantes, sans supposer la possibilité d'une relation non linéaire et en suggérant que la relation pourrait changer à des concentrations circulantes plus élevées.
Ces dernières années, des effets dose-réponse en forme de U ont été rapportés pour plusieurs autres vitamines, ce qui ne nous préoccupait pas auparavant. Début 2022, Xu et al ont signalé que des taux sériques élevés de folate pouvaient augmenter le risque de maladie cardiovasculaire dans certaines populations.4Quelques mois plus tôt, en septembre 2021, des chercheurs rapportaient que la vitamine B12L’association avec la mortalité toutes causes confondues était également en forme de U et des taux sériques plus élevés augmentaient le risque de décès.5
Bien que chacune de ces relations doive être examinée individuellement et de manière beaucoup plus approfondie avant de pouvoir confirmer ou infirmer leur validité, leur publication collective dans un laps de temps aussi court m'amène à me demander si nous observons cette nouvelle tendance seulement maintenant parce que les chercheurs n'ont commencé à la rechercher que récemment, ou s'ils se sentent désormais simplement à l'aise de rapporter ce qu'ils observent dans leurs données.
L’idée selon laquelle différentes doses d’une substance pourraient avoir des effets remarquablement différents sur les systèmes biologiques remonte à la loi d’Arndt-Schulz, qui décrit de telles relations dose-réponse en deux phases. Cependant, ce concept a été fortement « marginalisé » pendant de nombreuses années car étroitement lié à l’homéopathie. L’utilisation du terme correct hormèse pour décrire les réponses dose-réponse biphasiques constituait un obstacle à la publication.6Ces dernières années, il est devenu courant dans les publications scientifiques de décrire les réponses à la dose hormétique en forme de U ou de J, le terme hormèse étant complètement éliminé de la discussion. Cette récente « acceptation » semble avoir permis la publication d’un nombre rapidement croissant d’articles décrivant des effets de dose qui correspondent clairement à la définition de l’hormèse, même s’ils sont simplement décrits comme des courbes en forme de U.
Cet article récent de Tian et al. devrait certainement nous amener à nous demander si beaucoup de nos patients ne se font pas de mal à long terme en prenant des doses quotidiennes de vitamine C et en maintenant des taux sériques de vitamine C plus qu'adéquats. Les efforts précédents pour étudier la vitamine C se sont d’abord concentrés sur les avantages de la réduction des dommages associés à une carence, puis ont examiné les avantages à long terme de la vitamine C contre diverses maladies. Cette étude pourrait être l’une des premières à rechercher spécifiquement les méfaits à long terme associés à la consommation. Aurions-nous même remarqué un problème si nous n'avions pas su le rechercher ?
Nous devrions peut-être utiliser les données de Tian et al. utiliser et dire qu'en l'absence de preuves concrètes de besoin, notre objectif devrait être de maintenir les niveaux sériques de vitamine C proches de 1,06 mg/dL, ou alternativement, les niveaux suggérés par Jayedi et al. dose quotidienne suggérée de 125 mg/jour à utiliser. J’écris « peut-être » parce que de telles suggestions peuvent sembler étonnamment basses tant aux patients qu’aux médecins et nécessiteraient l’abandon d’hypothèses de longue date.

 Suche
Suche
 Mein Konto
Mein Konto