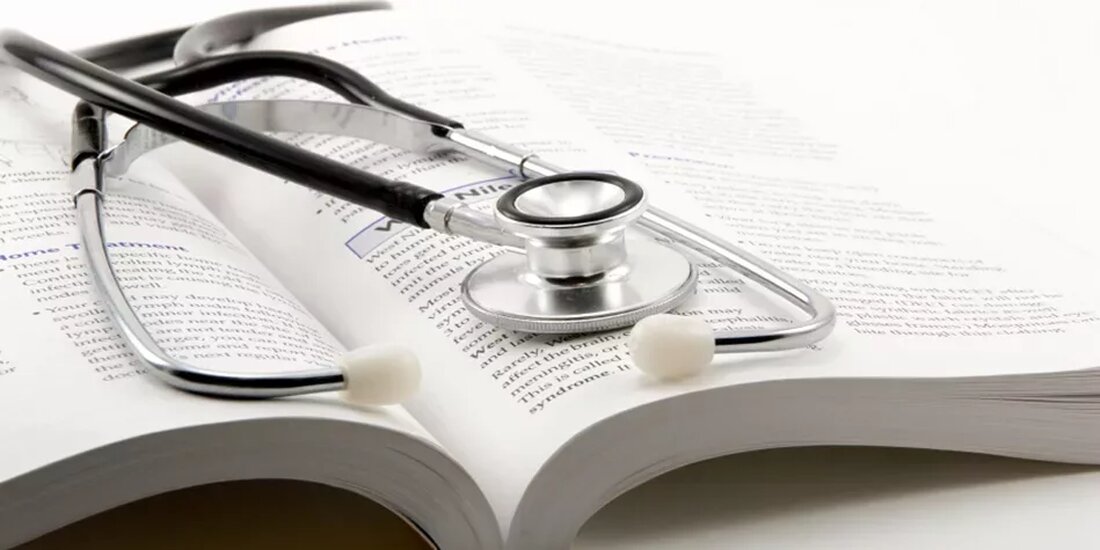référence
Catalina-Romero C, Calvo E, Sánchez-Chaparro MA et al. La relation entre le stress au travail et la dyslipidémie.Scand J Santé Publique.2013;41(2):142-149.
conception
Analyse transversale observationnelle en complément de l'étude de cohorte Ibermutuamur Cardiocular Risk Assessment (ICARIA) basée sur l'assurance.
Participant
L'étude a porté sur 73 332 salariés d'une compagnie d'assurance en Espagne, âgés de 18 à 60 ans. Environ 70 % de l'échantillon était des hommes. Au total, 6 239 (8,5 %) ont signalé un stress professionnel tel que défini dans l'étude INTERHEART.1
Paramètres de l'étude évalués
Stress au travail, cholestérol total, LDL-C, HDL-C, triglycérides, âge, sexe, tabagisme, consommation d'alcool, obésité, niveau professionnel, activité physique de loisir et recours à un traitement hypolipidémiant.
Mesures des résultats principaux
Relations bivariées et multivariées entre le stress au travail et les taux de lipides (par exemple cholestérol total, LDL-C, HDL-C, triglycérides)
Principales conclusions
Le stress au travail était associé de manière significative au sexe féminin, à l’âge, au niveau d’éducation, au fait d’occuper un poste de « col blanc » et à la dyslipidémie, y compris un diagnostic antérieur ou actuel de dyslipidémie, un traitement hypolipidémiant et/ou un taux de cholestérol total élevé, de LDL-C et un faible taux de HDL-C.
L'ajustement multivarié selon l'âge, le sexe, le statut tabagique, la consommation d'alcool, l'obésité, le niveau professionnel et l'activité physique n'a pas réduit les associations entre la dyslipidémie et le stress au travail.
Effets sur la pratique
Cette analyse de Catalina-Romero et al2Fournit au clinicien un rappel important de la contribution du stress psychosocial, y compris le stress professionnel, au risque cardiovasculaire. Leurs résultats confirment les résultats antérieurs de l'étude cas-témoins INTERHEART, qui ont révélé que le stress au travail représente 8 % du risque de premier infarctus du myocarde (IM) dans la population.3Les découvertes de Catalina-Romero et de ses collègues sont également étayées par la vaste étude de métacohorte réalisée par Kivimaki et ses collègues.4Elle combinait des données individuelles provenant de 30 études européennes différentes et incluait un total de 197 473 participants, dont 15 % ont signalé un stress professionnel. L'exposition professionnelle s'est avérée être un facteur de risque indépendant important de maladie coronarienne, contribuant à un risque basé sur la population (PAR) de 3,4 %.
Outre le stress au travail, d’autres domaines de stress psychosocial sont également associés au risque d’événements cardiovasculaires. Dans l’étude INTERHEART1.3Une faible capacité de contrôle, un stress financier, un stress grave passé (par exemple, une faillite d'entreprise, une dépression et un stress chronique au travail ou à la maison) étaient tous associés à un risque accru d'IM, représentant 16 %, 11 %, 10 %, 9 %. soit 8% du PAR pour le premier IM. Ensemble, ces facteurs ont contribué à 32,5 % du PAR pour le premier infarctus du myocarde.
Afin de pouvoir prévenir de manière globale les patients à risque de maladies cardiovasculaires (c'est-à-dire tous), les facteurs de stress psychosociaux doivent être enregistrés et idéalement quantifiés. Bien entendu, il est essentiel d’établir une relation thérapeutique sûre dans laquelle les patients se sentent capables de parler ouvertement de leurs stress de la vie et de leur impact sur leurs comportements en matière de santé. Questionnaires cliniques (c'est-à-dire des « écrans » tels que le questionnaire sur la santé du patient).5.6et le GAD-76) proposent des outils de dépistage rapide de la dépression ou de l’anxiété. D'autres domaines de la santé psychosociale peuvent être évalués au moyen d'un historique détaillé du patient ou en incluant des questionnaires supplémentaires dans une collecte clinique (par exemple, un questionnaire incluant le site de contrôle). L'utilisation d'outils tels que le questionnaire sur la santé du patient peut faciliter le conseil, la thérapie cognitivo-comportementale ou d'autres interventions et peut être utilisée à long terme pour garantir le progrès thérapeutique. Dans ma clinique, nous fournissons des soins intégratifs complets pour les maladies cardiovasculaires et avons recréé l'indice de stress psychosocial INTERHEART et l'avons intégré à notre apport initial, nous permettant de quantifier et de traiter rapidement les éléments psychosociaux critiques du risque de maladie.
Malgré l'ajustement de nombreuses variables potentiellement confusionnelles telles que l'activité physique, le tabagisme, l'âge et le sexe, il aurait également été intéressant de voir si l'ajustement du comportement alimentaire et/ou des habitudes alimentaires aurait influencé les résultats de Catalina-Romero et de ses collègues. L'intégration de pratiques alimentaires aurait probablement réduit l'ampleur des associations entre la charge de travail et le risque lié aux lipides, car le stress psychosocial et la charge de travail étaient spécifiquement associés à une consommation accrue d'aliments à forte densité énergétique et à une consommation plus faible de fruits et légumes.7Lorsque l’on considère les prédicteurs sociaux d’une consommation accrue de fruits et légumes et la connaissance d’une alimentation saine, une plus grande efficacité personnelle et un plus grand soutien social s’avèrent cruciaux.8.9Comprendre ces contributeurs offre au clinicien de nombreuses opportunités d’influencer les comportements liés à la santé. Dans la pratique clinique, un soutien social et une éducation sur des habitudes alimentaires saines ainsi que l’encouragement à des changements alimentaires sont possibles. Les preuves disponibles suggèrent que les praticiens intégrateurs, tels que les médecins naturopathes, ont la capacité d'améliorer le comportement, y compris les pratiques nutritionnelles, chez les patients présentant un risque accru de maladie cardiovasculaire.10,11
Il convient de noter que développer la confiance nécessaire pour changer de comportement et promouvoir l’efficacité au travail et à la maison peut s’avérer difficile pour les patients souffrant de stress professionnel et de très faibles niveaux de contrôle sur le lieu de travail. L'oppression sur le lieu de travail favorise une perte de confiance en soi et limite fondamentalement l'efficacité personnelle. Cependant, tout le monde ne peut pas changer d’employeur ou de poste. Ce scénario nécessite un soutien supplémentaire du patient et souvent une formation cognitivo-comportementale spécifique pour se réengager dans les activités de la vie quotidienne et promouvoir des activités dans lesquelles le patient peut conserver un plus grand contrôle. Étant donné que le soutien social est un indicateur important de l'augmentation de la consommation de fruits et légumes, la création d'un groupe de soutien aux maladies cardiovasculaires ou d'un cours de cuisine en groupe sur le régime méditerranéen est un moyen amusant et efficace de fournir une éducation et un soutien social et d'augmenter l'auto-efficacité en une seule intervention.
L’identification et le traitement des facteurs de risque psychosociaux sont nécessaires au traitement holistique des maladies cardiovasculaires et à la prévention des maladies cardiovasculaires. Comme Catalina-Romero et al. ont montré que si la nutrition et l’éducation sanitaire sont des éléments importants dans la réduction des risques, des facteurs externes tels que la charge de travail ont également un impact important sur le risque. De plus, pour de nombreuses personnes, le stress professionnel s’étend également aux comportements en dehors du lieu de travail et peut avoir un impact négatif direct sur le risque de maladie. Même si, sur le lieu de travail, l'accent est de plus en plus mis sur l'accès des employés à des aliments plus sains, paradoxalement, une intervention plus efficace sur le lieu de travail consiste à créer un environnement de travail dans lequel les employés se sentent en confiance, valorisés et ont la liberté d'accomplir leurs tâches sans oppression.

 Suche
Suche
 Mein Konto
Mein Konto