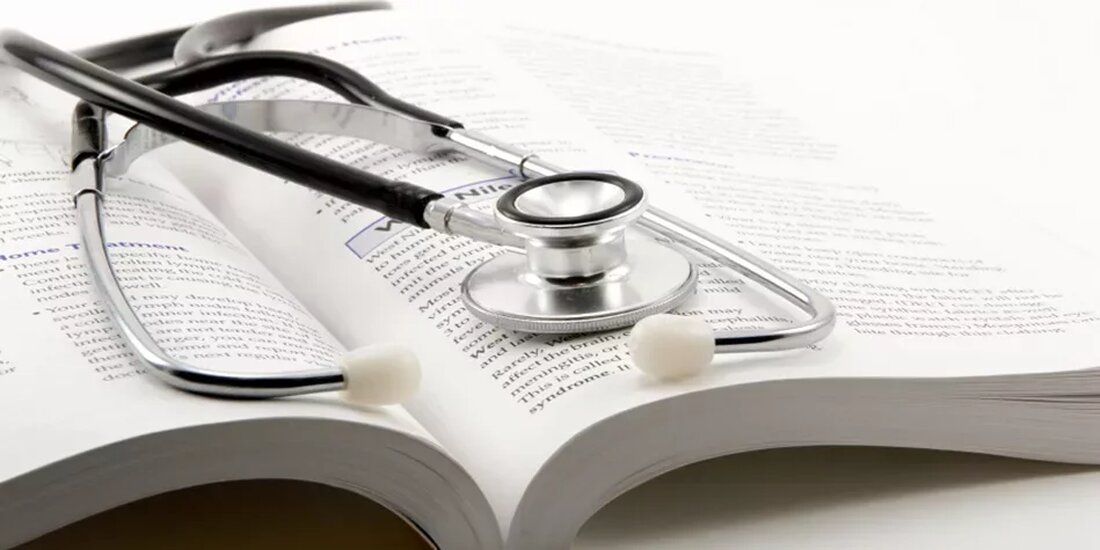Relation
Vera AM, Peterson LE, Dong D et al. Forte prévalence de variantes génétiques du tissu conjonctif dans le ballet professionnel.Am J Sports Med. 2020;48(1):222-228.
Objectif
Déterminer la prévalence des variantes génétiques du tissu conjonctif chez les danseurs de ballet professionnels et comprendre si une hypermobilité articulaire accrue ou la présence de variantes génétiques ont amélioré la position d'un danseur de ballet au sein d'une compagnie.
Brouillon
Étude transversale
Participant
Cette étude a porté sur 51 danseurs de ballet professionnels adultes, hommes (n = 26) et femmes (n = 25), d'une grande compagnie de ballet métropolitaine, dont 32 ont subi des tests génétiques. L'âge variait de 18 à 35 ans avec une moyenne de 23,9 ans.
Paramètres de l'étude évalués
Les auteurs ont évalué l'hypermobilité articulaire généralisée des 51 participants à l'aide d'un score de Beighton, de scores de performance élective de la hanche et de la cheville et des critères de Brighton, un outil clinique qui facilite le diagnostic des syndromes d'hypermobilité articulaire généralisée. Trente-deux participants ont accepté de subir des tests génétiques et ont été dépistés pour 60 variantes différentes du tissu conjonctif. Ces variantes ont été regroupées dans les groupes suivants : syndrome d'Ehlers-Danlos (EDF) ; Marfan ; Loeys-Dietz ; Myopathie de Bethlem ; et la morphologie des muscles, du squelette et du tissu conjonctif.
Mesures des critères de jugement principaux et résultats clés
Sur les 32 danseurs ayant participé à l’analyse ADN, 28 (88 %) présentaient au moins 1 variante parmi les 60 gènes testés. Les chercheurs ont trouvé un total de 80 variantes. Ils ont trouvé une variante dans 26 des 60 gènes chez au moins un danseur. Les critères de Brighton étaient positifs chez 31,3 % des participants et 53,1 % avaient un score de Beighton positif. Aucune autre variante de la maladie du tissu conjonctif n’a été trouvée.
Les auteurs n'ont trouvé aucun avantage au sein de l'entreprise (directeur par rapport à l'apprenti) pour les personnes présentant des variantes du tissu conjonctif. Ils ont constaté que les danseurs présentant des variantes des groupes Marfan et Loeys-Dietz présentaient une atteinte réduite de la hanche.
commentaire
Les troubles héréditaires du spectre hypermobile (HSD) sont une cause croissante de douleur chronique et de dysfonctionnement multisystémique.1Cette étude contribue à définir la prévalence de variantes du tissu conjonctif non signalées et sous-déclarées auparavant. Les chercheurs ont évalué 8 gènes qui n’ont jamais été signalés ou qui seraient présents chez <0,0001 % de la population.
Ces données sont étonnantes. Soit ces variantes génétiques du tissu conjonctif sont significativement plus courantes que celles signalées précédemment, soit les danseurs de ballet sont significativement surreprésentés, soit les deux. Ces informations peuvent aider les médecins qui soupçonnent des causes secondaires de douleur à dépister une HSD sous-jacente en prenant des antécédents appropriés. Il peut être utile pour le dépistage de simplement demander à vos patients s'ils ont déjà fait du ballet, de la gymnastique ou du cheerleading.
Il existe de nombreux mythes à propos du HSD. Par exemple, les patients n’ont pas besoin d’antécédents de luxation articulaire ouverte pour répondre aux critères diagnostiques de 2017 du syndrome hypermobile d’Ehlers-Danlos (hEDS) ou HSD.2Les cliniciens peuvent négliger l’HSD dans leur différentiel chez les patients souffrant de douleur chronique en raison de la rareté perçue de ces troubles. Il y a vingt ans, une prévalence de 1/5 000 (0,0002 %) était rapportée.3et des études plus récentes le donnent en 1/500 (0,002 %).4La véritable prévalence est inconnue en raison du manque de reconnaissance et d’application de critères diagnostiques appropriés. Cette compréhension insuffisante a conduit à une augmentation de la souffrance des patients et à des erreurs de diagnostic telles que la fibromyalgie, la sensibilisation centrale à la douleur et/ou les troubles psychiatriques.5
Cette étude est considérablement limitée par l’absence d’une population témoin du même âge. Des contrôles adaptés à l'âge auraient pu aider à déterminer si les variantes sous-déclarées sont réellement surreprésentées chez les danseurs de ballet. Bien qu'il soit impressionnant que 88 % des participants présentaient une variante identifiable, bon nombre des variantes les plus courantes ne sont pas signalées dans la base de données sur les mutations génétiques humaines ou dans Ensembl, et nous n'avons donc aucun moyen de savoir si ces variantes sont significativement plus élevées par rapport à une population non-Ballet. Par exemple, la variante la plus couramment identifiée était le gène TTN, impliqué dans la morphologie musculaire. Ce variant a été retrouvé 22 fois, mais sa fréquence dans la population générale est inconnue. De plus, les données sur l’origine ethnique ne sont pas enregistrées, ce qui est susceptible d’avoir un impact sur la fréquence des variants.
Ces données sont étonnantes. Soit ces variantes génétiques du tissu conjonctif sont significativement plus courantes que celles signalées précédemment, soit les danseurs de ballet sont significativement surreprésentés, soit les deux.
Malheureusement, les auteurs n’ont pas signalé ni analysé les patients chez lesquels > 1 variant était présent. Cela était probablement dû à la petite taille de l’échantillon. Par exemple, ils ont trouvé 3 variantes auTNXBGen, 2 auADAMTS22 surCOL1A2et 1 àCOL1A1. Ceux-ci sont chacun associés aux formes suivantes du syndrome d'Ehlers-Danlos : classique, dermatosparatique, valvulaire et classique. Les auteurs auraient dû réaliser des échocardiogrammes sur tous les danseurs porteurs des gènes Marfan, EDS ou Loeys-Dietz. Les auteurs ne précisent pas si ces danseurs présentant des variantes EDS connues seraient plus susceptibles de répondre aux critères de Brighton. Si cette information avait été rapportée, elle pourrait nous aider à mieux comprendre ces maladies. Ceci est probablement présent dans leurs données mais n’est pas signalé.
Cette étude a utilisé les critères obsolètes de Brighton de 1998 pour identifier les participants souffrant de trouble hypermobile.6Les critères de Brighton ont été remplacés en 2017.7Les critères de Brighton ont déjà été utilisés pour identifier les patients atteints du syndrome d'hypermobilité articulaire bénigne (BJHD). Nous n'utilisons plus cette terminologie et ce trouble est désormais appelé trouble du spectre hypermobile (HSD), qui comprend le syndrome d'Ehlers-Danlos hypermobile (hEDS).
De plus, les chercheurs n’ont pas utilisé de mesures de résultats validées pour évaluer la douleur chronique. Bien que l’hypermobilité puisse présenter des avantages – par exemple une amélioration des performances dans une discipline qui nécessite des mouvements articulaires excessifs comme le ballet – il est important de comprendre qu’elle peut avoir des conséquences débilitantes.8.9
Sur la base de l'expérience clinique menée auprès de plus de 1 000 patients atteints d'HSD, je soupçonne que les patients plus gravement touchés peuvent être plus gravement touchés en raison d'une douleur intense, d'une instabilité articulaire, d'une blessure et de la présence d'autres conditions comorbides, telles que : POTS) ou le syndrome d'activation des mastocytes (MCAS).10,11
Les chercheurs tentent encore d’élucider la fréquence réelle de ces comorbidités qui se chevauchent, mais il existe de plus en plus de preuves selon lesquelles l’invalidité est plus importante chez les patients atteints de maladies multisystémiques.12Les médecins doivent comprendre que ces troubles peuvent conduire à un handicap global. La médecine intégrative est bien placée pour aider ces patients à améliorer la stabilité des articulations et le fonctionnement du système nerveux autonome et du système immunitaire si le praticien est disposé à approfondir la littérature.
Conclusion
Dans l’ensemble, cette étude a amélioré notre compréhension des variantes génétiques du tissu conjonctif hypermobile. Les études futures devront inclure des contrôles ajustés pour définir la véritable incidence chez les danseurs de ballet par rapport à la population générale. Ce travail ne parvient finalement pas à étayer leur hypothèse selon laquelle les variantes des gènes associés à l’hypermobilité seraient surreprésentées chez les danseurs de ballet professionnels. Nous devons également examiner l'origine ethnique des danseurs, les échelles de douleur validées et leur qualité de vie. Les critères diagnostiques actuels et la nomenclature des troubles du spectre hypermobile et du syndrome d'Ehlers-Danlos hypermobile doivent être utilisés. Bien que cette étude n'ait pas comparé la prévalence de l'HSD avec des témoins du même âge, les cliniciens devraient néanmoins envisager d'interroger leurs patients souffrant de douleur chronique sur leur participation antérieure au ballet, à la gymnastique et au cheerleading.

 Suche
Suche
 Mein Konto
Mein Konto