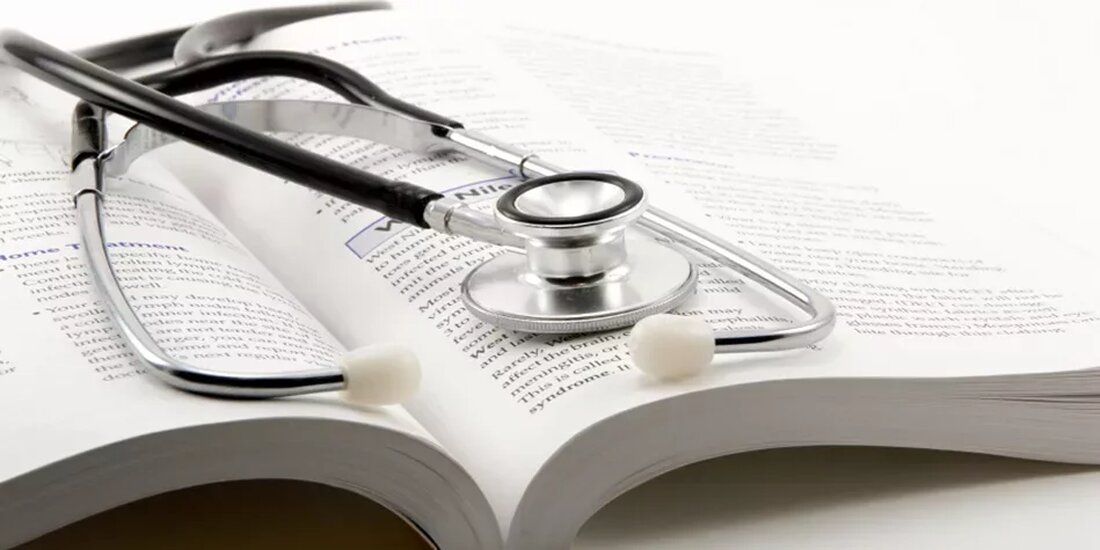Relation
EC Sud, Hohl BC, Kondo MC, MacDonlad JM, Branas CC. Effet du verdissement des terrains vacants sur la santé mentale : un essai contrôlé randomisé à l'échelle de la ville.Ouverture du réseau JAMA. 2018 ;1 (en cours de révision) :1–14.
Objectif de l'étude
Évaluer si le verdissement des terres urbaines non développées réduit la mauvaise santé mentale autodéclarée chez les adultes vivant dans la communauté.
Brouillon
Cette étude a inclus 541 terrains urbains vacants à Philadelphie sur la base des critères de « fléau » : végétation négligée, déchets, voitures abandonnées, etc. Ces terrains ont été sélectionnés dans le cadre d'un plus grand projet de rénovation urbaine « propre et vert » mené par la Philadelphia Horticultural Society.1Les lots ont été regroupés en 110 groupes de proximité avec des rayons de 0,25 à 0,50 miles et attribués au hasard à l'un des trois groupes d'intervention :
- Müllabfuhr: Alle sichtbaren Abfälle und weggeworfenen Gegenstände wurden vom Grundstück entfernt, überwucherte Vegetation wurde getrimmt/gemäht und monatliche Wartungsarbeiten wurden durchgeführt.
- Begrünung: Zusätzlich zu den oben genannten Aktivitäten wurden die Grundstücke in dieser Gruppe professionell eingeebnet, Rasenflächen und kleine Bäume gepflanzt und kurze Zäune um die Grundstücksgrenzen herum installiert.
- Kontrolle: An diesen Chargen wurde während der Dauer der Studie kein Eingriff durchgeführt. (Nach Abschluss der Studie wurden diese Grundstücke auch begrünt).
Participant
Les résidents urbains habitant l’un des regroupements de propriétés (N = 342) ont complété cette étude qui consistait à répondre à un sondage axé sur les perceptions de la « santé urbaine ». Cette enquête a été menée avant la procédure et à nouveau environ 18 mois plus tard après l'enlèvement/le verdissement des détritus. Les participants et les collecteurs de données n'ont pas été informés de l'intervention (c'est-à-dire que la collecte des données de l'enquête a été menée indépendamment du fait que l'intervention avait eu lieu sur des terrains vacants locaux). Les participants avaient un âge moyen de 44,6 ans (SD 15,1 ans), étaient à 60 % des femmes et 44 % avaient un revenu familial inférieur au seuil de pauvreté de 19 530 $.
Paramètres cibles
Dans le cadre d'une enquête plus vaste, les participants ont rempli l'échelle d'auto-évaluation de détresse psychologique Kessler-6 (K6) avant et après l'initiative d'écologisation/nettoyage/contrôle. Cette échelle mesure la fréquence des expériences subjectives récentes de nervosité, de désespoir, d'agitation, de dépression, d'inutilité et de tension. Une comparaison par paires des changements avant et après a été réalisée entre les groupes d'intervention à l'aide d'une régression de séries chronologiques transversales en intention de traiter.
Informations clés
Des réductions des échelles K6 se sont produites dans tous les groupes au cours des 18 mois de l'intervention, reflétant peut-être les changements survenus dans l'économie nationale au cours de la période d'étude (2011-2013, la période de reprise après la Grande Récession).
Indépendamment de ces changements de base, il y a eu une réduction significative des sentiments autodéclarés de dépression et d'inutilité parmi les résidents vivant dans les clusters verts par rapport aux clusters témoins. La dépression a été réduite de 42 % (IC à 95 % : -63,6 % à -5,9 % ;P.=0,03) et l'inutilité a diminué de 51 % (IC à 95 % : -74,7 % à -4,7 % ;P.=0,04), par rapport à l’absence de réduction significative dans les groupes témoins. Il y avait également une tendance à la réduction du score composite K6 (c'est-à-dire une mauvaise santé mentale globale autodéclarée) de 63 % (IC à 95 % : −86,2 % à 0,4 % ;P.= 0,051) par rapport au contrôle.
Pour les résidents vivant dans des ménages situés sous le seuil de pauvreté dans les clusters verts, la réduction de la dépression était encore plus importante (68,7 %) par rapport aux résidents du cluster témoin (IC à 95 % : −86,5 % à −27,5 % ;P.=0,007).
Il n'y avait aucune différence statistique entre les résidents du groupe d'élimination des déchets et les résidents du cluster témoin, ni dans les scores totaux K6, ni dans les scores des sous-échelles.
Implications sur la pratique
Il s'agit de l'une des premières études à utiliser un plan expérimental (c'est-à-dire une assignation aléatoire à des conditions variables ou témoins) pour l'approche des espaces verts urbains visant à promouvoir la santé publique. Contrairement aux études précédentes dans ce domaine, l’étude actuelle est en mesure d’attribuer la causalité directe des bienfaits pour la santé mentale au verdissement par rapport aux conditions de contrôle. Cette étape très importante permet une analyse directe des avantages (y compris une analyse coûts-avantages). [CBA]) de l’intervention afin qu’ils puissent être reproduits, étendus et développés en programmes viables à l’avenir. Une analyse ABC préliminaire d’une étude similaire a révélé un retour sur investissement (ROI) de 224 $ par dollar investi.2
Les résultats de cette étude démontrent l'importance des facteurs environnementaux dans l'influence sur la santé mentale individuelle et communautaire. Ces effets sont connus depuis de nombreuses années, tant dans des contextes cliniques et universitaires que par l’expérience humaine directe.3La plupart des gens sont conscients de la manière dont leur environnement peut influencer leur humeur, leur capacité de concentration et leur vision de la vie. Les stimuli de notre environnement ont un impact direct sur l'activité neuroendocrinienne et les fonctions affectives et cognitives correspondantes.4
Cela peut être particulièrement pertinent dans les environnements urbains modernes, où les stimuli peuvent être sensiblement différents et plus intenses que dans un paysage rural auquel nous sommes plus adaptés sur le plan évolutif.5La théorie du « stress urbain » suggère que la vie dans les villes peut être intrinsèquement moins saine (sur le plan évolutionnaire) en raison de ces « nouveaux » environnements. Une quantité importante de preuves soutient ce concept.6.7
Ce problème est particulièrement préoccupant pour la population urbaine mal desservie (c’est-à-dire les pauvres urbains). Ces populations souffrent de conditions de santé parmi les plus mauvaises du pays en raison de divers facteurs, notamment un accès limité aux soins de santé ; pollution de l'air, du bruit et de la lumière ; Crime; stress psychosocial; et une charge allostatique accrue.8En particulier, il a été démontré que la combinaison unique de la pauvreté et du délabrement urbain contribue directement aux taux plus élevés de dépression au sein de ces populations.9
On sait déjà que la verdure urbaine est bénéfiquephysiquementSanté, en particulier pour les pauvres des zones urbaines. Dans une étude historique publiée dans lelancetteLes chercheurs ont montré que la proximité des espaces verts urbains était non seulement associée à une mortalité plus faible (après contrôle du statut socio-économique [SES]), mais que lorsque les groupes étaient stratifiés par statut socio-économique, l'effet des espaces verts était beaucoup plus important dans les groupes de statut socio-économique inférieur que dans les groupes de statut socio-économique élevé.10Pour les personnes situées au bas de l’échelle économique, le « pouvoir de guérison de la nature » peut constituer une ressource vitale importante.
De nombreuses études ont montré que les espaces verts urbains peuvent avoir un impact positif sur l'environnementspirituellementla santé. Les éditions précédentes du NMJ ont passé en revue certaines de ces études.11,12Une approche qui a été explorée pour améliorer la santé des pauvres en milieu urbain est le mouvement de « verdissement urbain » qui a émergé à travers le pays. Ces initiatives combinent les aspects salutogènes deBiophiliele concept popularisé par E.O. Wilson, qui suggère que les gens ont une affinité saine inhérente pour les lieux naturels, avec des programmes de santé publique tels que l'Initiative des lieux sains du CDC, aujourd'hui disparue.13,14La Philadelphia Horticultural Society est l'un des leaders nationaux non seulement dans la poursuite des efforts d'écologisation urbaine, mais également dans la collecte de données pour démontrer les avantages essentiels et l'efficacité de leurs programmes.15,16En réduisant le fléau urbain et en améliorant l’environnement local, il est possible de modifier les conditions dans lesquelles la santé, y compris la santé mentale et la qualité de vie, émerge.
Une limite de cette étude est le manque de données identifiant l'exposition directe des résidents urbains aux terrains vacants avant, pendant et après les interventions. Dans la présente étude, il n'est pas possible de lier les changements des valeurs K6 à l'utilisation ou à l'appréciation des propriétés revégétalisées par les participants. Cependant, la conception expérimentale de l’étude suggère qu’un aspect de causalité plutôt qu’une simple corrélation est apparu, comme indiqué ci-dessus. Les études futures souhaiteront peut-être ajouter une mesure de l'exposition individuelle aux espaces verts comme mesure supplémentaire pour l'analyse, mais cela n'enlève rien à la valeur ou aux résultats de l'étude actuelle.
Conclusions
Cette étude étend l’idée de « médecine » au-delà du niveau d’impact personnel et montre que les interventions de santé publique à grande échelle, en particulier celles qui impliquent de rendre plus écologiques les environnements dans lesquels nous vivons, travaillons et jouons, peuvent améliorer considérablement la santé mentale et le bien-être d’une communauté, en particulier pour les membres les plus vulnérables de la société.

 Suche
Suche
 Mein Konto
Mein Konto